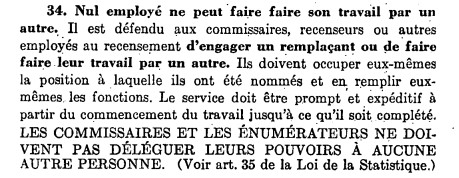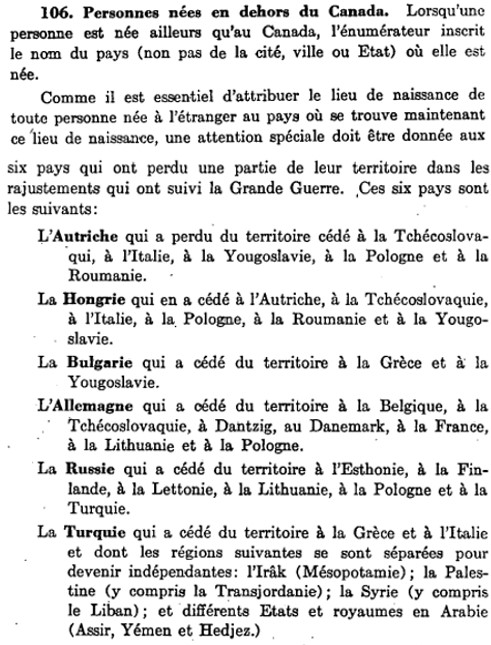Par Ellen Bond
Remporter une compétition internationale et entendre son hymne national dans l’aréna, c’est le rêve de bien des hockeyeurs canadiens. En janvier 2020, le Canada s’est couvert d’or en défaisant la Russie en finale du Championnat mondial junior de la Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF). Chaudement disputé, le tournoi masculin a été suivi par des millions de personnes dans le monde entier. Pourtant, à peine quelques jours plus tôt, c’est un auditoire beaucoup plus petit qui a regardé le duel entre le Canada et les États-Unis au Championnat du monde de hockey sur glace féminin des moins de 18 ans.
Contrairement au basketball, où l’on réduit la taille du ballon pour les femmes, et au volleyball, où l’on abaisse le filet, le hockey se pratique de la même façon chez les deux sexes. Certes, les femmes jouent « sans contact », mais on ne change ni le format de la patinoire, ni les dimensions des buts, ni la taille ou le poids de la rondelle. D’ailleurs, si le hockey a vu le jour au début des années 1870, les femmes ont adopté ce sport à peine deux décennies plus tard. Une question s’impose donc : comment se fait-il que le hockey féminin, après des débuts prometteurs, n’ait pas progressé comme le hockey masculin?

Groupe de femmes réunies pour jouer au hockey, Ottawa (Ontario), 1906. (PA-042256)
Enfant, tout ce que je voulais faire, c’était de jouer au hockey. Je me souviens d’avoir regardé mon frère jouer sur la glace avec plein d’autres garçons. Ils installaient de longs boyaux sur les lignes rouge et bleues pour diviser la patinoire en trois petites surfaces de jeu. Je voulais me joindre à eux, mais on ne laissait pas les filles jouer. Les choses ont toutefois changé dans les années 1970, quand nous avons déménagé à Campbellford, en Ontario. Un jour, au début de l’automne, un homme s’est présenté chez moi et a demandé à mon père s’il voulait être l’entraîneur de l’équipe des filles. Mon père a dit oui, et au début de ma huitième année scolaire, j’ai commencé à jouer dans une ligue.

Mon équipe la première année où j’ai eu le droit de jouer au hockey. Nous avons remporté le championnat. Je suis la troisième à partir de la gauche dans la rangée du haut; on voit mon père à droite et mon frère accroupi devant lui. (Photo fournie par l’auteure)
Une question m’est donc venue en tête : si les femmes et les hommes ont commencé à pratiquer ce sport à la fin du 19e siècle, pourquoi n’avais-je pas eu le droit de jouer avant mon arrivée à Campbellford, même si j’ai grandi dans une ville relativement grande?

« La reine de la glace ». Une femme en patins de figure sur une patinoire avec un bâton de hockey dans les mains, 1903. (C-3192610)
Selon l’Association de hockey féminin de l’Ontario, la première partie opposant des femmes a eu lieu en 1891 à Ottawa, en Ontario. À l’époque, l’Université de Toronto, l’Université Queen’s et l’Université McGill avaient des équipes féminines, mais celles-ci étaient tenues de jouer à l’abri des regards masculins. En effet, mis à part les arbitres, aucun homme ne pouvait assister à la partie. En 1914, le premier championnat provincial féminin s’est déroulé à Picton, en Ontario. Il a mis aux prises six équipes, dont certaines représentaient des universités. Ensuite, en 1921, l’Université de Toronto a vaincu l’Université McGill pour remporter le premier championnat universitaire féminin au Canada. Grâce à ces équipes et à d’autres, le sport a continué de croître, bien que de façon irrégulière, pendant les années 1920 et 1930.
Puis, tout s’est arrêté net. Peut-être était-ce parce qu’on jugeait le hockey trop violent pour les filles, comme l’a affirmé Clarence Campbell, président de la Ligue nationale de hockey, en 1946. Ou parce qu’à certains endroits, il était interdit de regarder les femmes jouer. Ou parce qu’on trouvait la chose frivole, ou les joueuses trop passionnées. Ou encore, comme l’avance Wayne Norton dans le livre Women on Ice : The Early Years of Women’s Hockey in Western Canada, parce qu’à l’issue d’un vote en 1923, l’Association canadienne de hockey amateur s’est opposée à la reconnaissance officielle du hockey féminin. Dans le livre Too Many Men on the Ice : Women’s Hockey in North America, Joanna Avery et Julie Stevens soutiennent que la participation du Canada à la Seconde Guerre mondiale a entraîné le déclin du hockey féminin. Quand la majorité des hommes sont partis combattre, beaucoup de femmes se sont mises à travailler dans les usines, ce qui leur laissait peu de temps pour s’amuser. Bref, quelle que fût la raison, notre sport de prédilection a été difficilement accessible aux femmes et aux filles pendant plusieurs décennies, et bon nombre d’entre elles n’ont jamais eu l’occasion de jouer au hockey.

Mademoiselle Eva Ault. Quand la Première Guerre mondiale a conduit les hommes en Europe, les femmes ont eu leur première chance de jouer au hockey dans un contexte professionnel. Eva Ault est devenue une favorite de la foule, mais la fin de la guerre a marqué la fin de la carrière des pionnières du hockey professionnel féminin. (PA-043029)

Une équipe de hockey féminin de Gore Bay, sur l’île Manitoulin (Ontario), 1921. Le nom des joueuses figure dans la notice. (PA-074583)
J’ai pu jouer au hockey de la huitième à la treizième année, aussi bien dans un cadre communautaire que scolaire à Peterborough, en Ontario. J’ai aussi eu la chance de faire partie des équipes universitaires à McMaster et à Queen’s. C’est le plus près que je me suis approchée du niveau professionnel. On nous fournissait l’équipement, une patinoire pour les entraînements et les parties, et le transport pour chaque affrontement. À l’Université McMaster, le budget total de mon équipe était inférieur à ce que l’équipe masculine dépensait juste pour les bâtons, mais je me considérais chanceuse de pouvoir représenter mon université et de jouer avec et contre certaines des meilleures hockeyeuses au monde.
Parmi ces athlètes d’exception, il y avait Margot (Verlaan) Page et Andria Hunter. Toutes deux ont représenté le Canada aux championnats du monde. J’ai joué avec Margot pendant trois ans à l’Université McMaster. C’était la capitaine et la meilleure sur la glace. À l’époque, c’était le plus haut niveau qu’il lui était possible d’atteindre. Elle a par la suite défendu les couleurs du Canada aux championnats du monde de l’IIHF de 1987 (événement non sanctionné), 1990, 1992 et 1994. Puis, de 2000 à 2007, elle a dirigé les équipes féminines canadiennes aux championnats de l’IIHF et aux Jeux olympiques. Aujourd’hui, Margot est entraîneuse en chef de l’équipe féminine des Badgers de l’Université Brock. Quant à Andria, je l’ai rencontrée lorsque nous vivions toutes deux à Peterborough. Je travaillais comme monitrice au camp Quin-Mo-Lac alors qu’elle était campeuse. Comme nous vivions dans une petite ville, nous nous croisions souvent. J’ai demandé à Andria comment se sont déroulés ses débuts au hockey. Voici son histoire, traduite en français :
J’ai commencé à jouer au hockey en 1976. C’était plutôt rare, à l’époque, de voir des filles pratiquer ce sport. J’ai eu la chance de me trouver à Peterborough au moment où le hockey féminin commençait à se développer. À ce moment-là, bien des petites villes n’avaient aucune équipe féminine. La première année, j’ai joué avec des garçons dans une ligue locale, mais par la suite, j’ai toujours pu jouer avec des filles.
Toute mon enfance, j’ai rêvé de jouer au niveau universitaire, parce que c’était le plus haut niveau à l’époque. Il n’y avait pas d’équipe nationale, donc il fallait évidemment oublier les championnats du monde et les Jeux olympiques. J’ai toutefois été très chanceuse que le hockey féminin connaisse des changements majeurs au bon moment pour moi.
Je me suis retrouvée dans une équipe universitaire américaine grâce à une bourse d’études;c’était une des premières fois aux États-Unis qu’une femme étrangère recevait une bourse pour jouer au hockey J’ai aussi pu faire partie d’Équipe Canada en 1992 et en 1994! Je me suis toujours dit que si j’étais née à peine cinq ans plus tôt, je n’aurais possiblement pas vécu ces merveilleuses expériences.
De 1990 à 1996, j’ai joué à l’Université de Toronto, où je faisais mes études supérieures. C’était une période de transition tumultueuse pour le programme. À ma première année, nous rangions notre équipement dans un petit casier. Les parties se divisaient en trois périodes de seulement quinze minutes, et la surfaceuse passait une seule fois. Puis, pendant la saison 1993-1994 (j’étais alors partie jouer en Suisse), le programme de hockey féminin a failli être éliminé, mais de nombreuses personnes se sont ralliées pour le sauver. À mon retour à l’Université de Toronto, l’année suivante, le hockey féminin était devenu un sport de haute performance. Nous avions maintenant quatre entraînements de deux heures par semaine, et nous ne rangions plus notre équipement dans des casiers!
J’ai aussi joué dans la Ligue nationale de hockey féminin (LNHF) à ses débuts. Quand je portais le chandail des Ice Bears de Mississauga, notre propriétaire enthousiaste a trouvé le moyen de nous faire jouer au Hershey Centre [aujourd’hui le Paramount Centre], où nous avions même notre propre vestiaire. Malheureusement, nous n’attirions pas assez de spectateurs pour rester dans un aréna aussi cher, ce qui a entraîné notre déménagement à Oakville après deux saisons.
Depuis que j’ai quitté la LNHF, en 2001, le hockey féminin a poursuivi sa croissance. Aujourd’hui, la société voit assurément le sport féminin d’un bien meilleur œil que lorsque j’étais enfant. Le niveau de jeu est rehaussé parce que les filles ont plus d’occasions de se développer. La qualité des entraîneurs, le degré de compétitivité et le temps de glace au niveau amateur y sont certainement aussi pour quelque chose. Il y a également plus d’équipes universitaires au Canada et aux États-Unis, et plus de ressources pour les joueuses. Malheureusement, on a encore de la difficulté à attirer les foules, et les débouchés professionnels sont limités. Heureusement, il y a de plus en plus de place pour les femmes derrière les bancs.

Photographie de l’équipe de hockey féminin de l’Université Queen’s, 1917. Certains noms figurent dans la notice. (PA-127274)
Comme l’a dit Andria, les filles qui veulent jouer au hockey aujourd’hui ont maintes possibilités. Il y a beaucoup d’équipes partout au Canada. Les jeunes hockeyeuses peuvent viser de nombreuses équipes universitaires, la première division de la National Collegiate Athletic Association (NCAA), aux États-Unis, et des équipes dans plusieurs pays d’Europe. Elles peuvent rêver de représenter leur pays aux Jeux olympiques et aux championnats du monde. Des millions de téléspectateurs ont pu voir l’élite des joueuses canadiennes et américaines s’affronter à 3 contre 3 pendant le week-end des étoiles de la LNH à Saint-Louis, au Missouri. À mesure que le hockey féminin poursuivra sa croissance, les rivalités entre pays se développeront. Et qui sait, la LNH lancera peut-être un jour une division féminine?
Dans tous les cas, l’avenir s’annonce prometteur pour les jeunes filles qui rêvent de jouer au hockey. Margot, Andria et moi avons tiré bien des leçons de vie de ce sport dans notre jeunesse, et nous sommes enchantées pour les filles d’aujourd’hui quand nous voyons toutes les perspectives que leur réserve le merveilleux sport qu’est le hockey.
Ellen Bond est assistante de projet à la Division du contenu en ligne de Bibliothèque et Archives Canada.