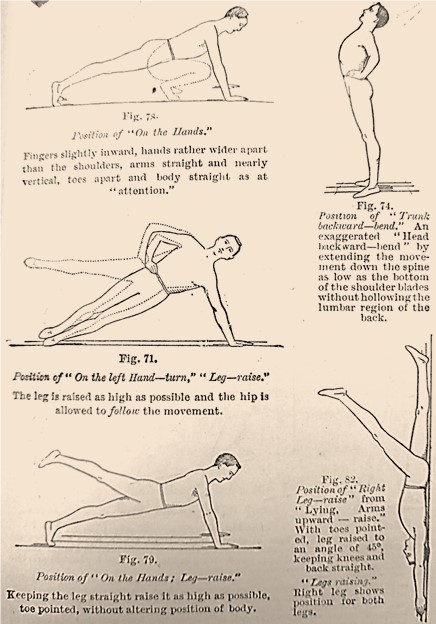English version
 Par Beth Greenhorn
Par Beth Greenhorn
Cet article renferme de la terminologie et des contenus à caractère historique que certains pourraient considérer comme offensants, notamment au chapitre du langage utilisé pour désigner des groupes raciaux, ethniques et culturels. Pour en savoir plus, consultez notre Mise en garde – terminologie historique.
Dans la première partie de cette série de quatre, j’ai parlé de mon grand-père Robert Roy Greenhorn (1879-1962). J’ai découvert qu’il était un petit immigré anglais et qu’il avait été pensionnaire dans les orphelinats de Quarrier, en Écosse. Dans la deuxième partie, nous nous rendrons dans les villes écossaises où sont nés mon grand-père et ses parents : Gartsherrie et Falkirk.
Je tiens à remercier Anna Greenhorn, sa fille Pat Greenhorn et ma cousine Joyce Madsen, qui ont généreusement partagé leurs souvenirs de Robert Roy Greenhorn.

Anciens pensionnaires des orphelinats de Quarrier, en Écosse, photographiés à l’orphelinat Fairknowe, à Brockville (Ontario), entre 1920 et 1930 (a041418). Cette photo a été prise environ 30 ans après l’arrivée de mon grand-père Robert et de ses frères.
Les chercheurs en généalogie sont souvent confrontés à des documents ou des renseignements manquants ou incomplets. Il faut donc consulter une gamme d’archives et de documents publiés pour établir des liens dans la vie de la personne recherchée. C’est particulièrement vrai si celle-ci n’était ni riche ni célèbre.
Pour reconstituer la vie de mon grand-père, j’ai rassemblé des faits trouvés dans des recensements canadiens, des listes de passagers et des documents sur les petits immigrés anglais. En plus de ces ressources conservées à BAC, j’ai consulté des sources primaires numérisées sur Ancestry, des recensements écossais, des publications historiques, des journaux et des expositions en ligne.
Mon oncle John et ma tante Anna (le frère et la belle-sœur de mon père) ont fait des recherches sur la famille Greenhorn, et je leur en suis très reconnaissante. Je remercie spécialement ma tante de m’avoir donné des photocopies de deux pages tirées de grands livres :
- la page 40, intitulée « Greenhorn, John & Robert », qui contient des entrées pour le 10 décembre 1885, le 11 juin 1886 et le 15 mars 1889;
- la page 285, intitulée « Greenhorn, Norval », qui contient des entrées pour les 6 et 8 juillet 1892, le 29 mars 1894 et le 25 novembre 1904.
J’ai demandé à l’équipe de Quarriers Aftercare à Bridge of Weir, en Écosse, de vérifier la source de ces documents photocopiés. J’attends encore la réponse, mais il s’agit probablement de copies de grands livres tenus par les orphelinats de Quarrier. Ces deux pages expliquent pourquoi mon grand-père Robert et ses frères, John et Norval, sont entrés à l’orphelinat et ont émigré au Canada. Elles nomment une personne qui a joué un rôle essentiel dans cette histoire : Jeanie Greenhorn, la sœur aînée de mon grand-père. Nous y reviendrons.
Étant donné que mes grands-parents Greenhorn, Robert et Blanche (née Carr), exploitaient une ferme laitière, j’ai présumé que mon grand-père venait d’une famille d’agriculteurs, ou qu’il avait à tout le moins grandi sur une ferme. Je n’aurais jamais pensé que sa famille faisait partie de la classe ouvrière pauvre, victime de l’industrialisation en Écosse. Mon arrière-grand-père, Norval Greenhorn (1839-1882), et son beau-père, mon arrière-arrière-grand-père John Fleming (1805-1887), étaient ferronniers dans les villages industriels de Gartsherrie et de Falkirk.
Gartsherrie est aujourd’hui une banlieue de Coatbridge. Cet ancien village industriel situé environ 14 kilomètres à l’est de Glasgow est la ville natale de mon arrière-grand-mère Margaret Greenhorn (née Fleming, 1845-1885). En 1843, l’usine sidérurgique de Gartsherrie est probablement le plus grand producteur mondial de fonte brute. En 1864, Andrew Miller décrit les villes de Coatbridge et de Gartsherrie de manière aussi imagée que déprimante :
Un visiteur qui se rend dans un district où l’on produit du fer, comme Coatbridge, doit être fort impressionné par toutes ces flammes qui jaillissent lors d’une nuit sombre. À quoi pourrait bien penser un homme qui n’aurait jamais vu une usine sidérurgique, ou qui n’en aurait même jamais entendu parler, […] et qui verrait pour la première fois [du haut de l’église de Gartsherrie] près de 50 hauts fourneaux qui crachent le feu, pendant que les innombrables cheminées et chaudières des usines et des forges environnantes émettent leur éblouissante lumière blanche, semblable à celle d’un météore dans la pénombre? (Traduction d’une citation tirée de la page Web The Bairds of Gartsherrie, North Lanarkshire Council)
La photo ci-dessous de l’usine sidérurgique de Gartsherrie, prise au milieu de la décennie 1870, montre les hauts fourneaux (utilisés pour la fonte des minerais) de l’aile la plus récente, bâtie sur le canal Monkland. L’aile plus ancienne, de l’autre côté du canal, avait elle aussi huit fourneaux, pour un total de seize.
Dans l’Ordnance Gazetteer of Scotland (Francis H. Groome [directeur de publication], 1884, vol. I, p. 273), Coatbridge est ainsi décrit : « Le feu, la fumée, la suie et le vacarme généré par la machinerie sont ses principales caractéristiques. La lumière des fourneaux dans la nuit donne l’impression qu’il y a eu une grosse explosion. » [Traduction]
Selon le recensement de l’Écosse réalisé en 1851 (les recensements écossais peuvent être consultés sur Ancestry), mon arrière-grand-mère Margaret Fleeming [sic], âgée de six ans, vivait à Gartsherrie. Son père, John Fleeming [sic], 43 ans, était chargeur de fourneaux (furnace filler). Je suppose qu’il travaillait à l’usine sidérurgique de Gartsherrie, car la famille vivait au 154, North Square. Il s’agit d’une des résidences bâties pour les ouvriers par la société William Baird and Company, fondatrice de l’usine. Ces résidences étaient abandonnées au moment où la photo ci-dessous a été prise, en 1966. Elles ont été démolies en 1969.
Un plan des rues tracé en 1930 montre que les résidences North Square sont coincées entre deux voies de chemin de fer. De plus, l’usine sidérurgique et ses hauts fourneaux sont visibles de cet endroit. Selon la page anglaise de Wikipédia sur Coatbridge, la plus grande partie des résidents vivent dans d’étroites rangées de maisons situées tout près de l’usine sidérurgique. Dans ce milieu surpeuplé, les conditions de vie sont épouvantables et la tuberculose pullule.
L’Ordnance Gazetteer of Scotland (1883, vol. III, p. 80) explique qu’à Gartsherrie, « Il y a 400 bâtiments pour ouvriers comprenant chacun deux ou trois appartements, un petit lot à cultiver et un approvisionnement limité en gaz et en eau. » [Traduction] Le complexe sidérurgique comprend également une école pouvant accueillir 612 élèves (il y en avait 253 en 1881) et une école secondaire dont 400 des 666 places disponibles étaient occupées.
On peut supposer que les ferronniers et leurs familles s’évadaient rarement de la misère de Gartsherrie. La révolution industrielle prolonge les heures de travail, qui ne sont plus régulées par les saisons et le coucher du soleil. Les ouvriers travaillent de 14 à 16 heures par jour, six jours par semaine. Le tableau ci-dessous, peint en 1853, s’intitule Gartsherrie by Night; il montre les fourneaux en marche pendant la nuit.
Selon le recensement écossais de 1861, mon arrière-grand-père Norval Greenhorn vit avec ses parents et ses frères dans l’appartement 8 sur la rue Back Row, à Falkirk. Cette ville située environ 27 kilomètres au nord-est de Coatbridge fabrique du fer et de l’acier. Norval, âgé de 22 ans, semble travailler comme ferronnier.
Les conditions de vie des ouvriers ne semblent pas moins misérables qu’à Gartsherrie. D’après la Société d’histoire locale de Falkirk, la rue Back Row de l’époque victorienne (devenue la Manor Street) est étroite et sinistre. Des bâtiments insalubres et surpeuplés, reconnus pour leur état de délabrement, sont fréquemment frappés par des éclosions de choléra et de typhus.
Mes arrière-grands-parents Margaret et Norval Greenhorn se sont mariés en mars 1864. Étrangement, le recensement écossais de 1871 ne fait nullement mention de Norval dans la déclaration de Margaret. Celle-ci travaille comme domestique et vit avec ses parents, son frère, sa belle-sœur et son tout jeune neveu au 154, North Square (voir la troisième image ci-dessus), à Gartsherrie. Le recensement mentionne cependant une petite-fille, « James Grenham », âgée de six ans. Je crois qu’il s’agit de Jeanie Greenhorn, la plus vieille des enfants de Norval et Margaret, née en 1864. L’omission de Norval s’explique peut-être par le fait qu’il travaillait encore à Falkirk, bien que son nom ne soit pas mentionné là-bas, ni dans aucune autre déclaration du recensement de 1871.
Norval et Margaret ont eu sept ou huit enfants, dont quatre seulement ont survécu : Jeanie (1864-1938), John (1877-1961), mon grand-père Robert (1879-1962) et le cadet, Norval (1883-vers 1960).
Au moment du recensement écossais de 1881, Margaret et Norval vivent au 154, North Square, à Gartsherrie avec le père de Margaret (John Fleming) et leurs deux fils : mon grand-oncle John, trois ans, et mon grand-père Robert, deux ans plus jeune. John Fleming est un chargeur de fourneaux au chômage. Norval père travaille comme finisseur de chambres à air. Jeanie Greenhorn, 16 ans, a quitté le domicile parental et travaille comme domestique au service du fruitier George Bissett et de son épouse Sarah, à Cleland Place, environ 17 kilomètres au sud-est de Gartsherrie.
Les orphelinats en Écosse m’ont appris que mon arrière-grand-père Norval est mort d’une inflammation pulmonaire à la fin de décembre 1882. Son épouse Margaret devient donc veuve à 37 ou 38 ans, après le décès du soutien de famille. Elle est alors enceinte de leur fils Norval. Elle doit aussi prendre soin de ses deux fils âgés de cinq et trois ans.
On peut difficilement imaginer les souffrances et les inquiétudes de la mère et de sa progéniture. Les pages du grand livre fournies par ma tante Anna nous informent que Margaret est décédée le 3 décembre 1885 d’une insuffisance rénale. Mon grand-père et sa fratrie deviennent alors orphelins.
Les documents des orphelinats sur John et Robert Greenhorn disent que Jeanie a 20 ans et travaille comme domestique au service de Margaret Kerr (née Campbell) à la maison Gallowhill, à Paisley, lorsque sa mère, Margaret Greenhorn, tombe malade. Madame Kerr accorde un mois de « vacances » à Jeanie pour qu’elle accompagne sa mère dans ses derniers moments.
Un immense fardeau tombe sur les épaules de Jeanie. Elle doit soudainement prendre soin de ses trois petits frères âgés de moins de huit ans. Une telle situation serait pénible pour n’importe qui, mais c’est encore pire pour une domestique encore célibataire.
Jeanie connaissait sans doute le philanthrope William Quarrier. En 1876, il a fondé le City Orphan Home à Glasgow et, en 1878, il a ouvert l’Orphan Homes of Scotland à Bridge of Weir, environ 24 kilomètres à l’ouest de Glasgow. Du milieu des années 1870 à la fin de la décennie 1880, les journaux locaux publient régulièrement des articles qui louangent Quarrier pour son travail infatigable visant à venir en aide aux enfants nécessiteux à Glasgow et ailleurs en Écosse. Le Glasgow Herald du 28 mars 1884 parle d’un rassemblement organisé dans la ville, la veille du départ annuel d’une cohorte de garçons pour le Canada :
« Dans une grande ville aussi peuplée que Glasgow, […] il doit y avoir des organismes publics pour prendre soin des enfants nécessiteux qui n’ont plus personne pour prendre soin d’eux. […] La population a une immense dette envers M. Quarrier et son personnel. (Applaudissements) […] Tous les garçons partis au Canada dans l’espoir d’une vie meilleure ont été accueillis dans de belles maisons et ont pu choisir un emploi. […] Les villes canadiennes sont moins densément peuplées qu’ici et la pauvreté y est inexistante. Une bonne partie de la population travaille encore à la ferme. » (« Orphan Homes of Scotland », p. 9 [Traduction])
À peine quelques semaines avant le décès de Margaret Greenhorn, l’Evening News de Glasgow a publié un article intitulé « The Charitable Institutions of Glasgow: Their Past Work and Future Condition » (partie III, 16 novembre 1885, p. 2). Le texte louange William Quarrier, le décrivant comme « un homme remarquable […] qui fait un travail remarquable méritant d’être souligné. Bien avant que son nom soit connu du grand public, il était très populaire auprès des pauvres et des laissés-pour-compte à Glasgow » [Traduction].
Je ne saurai jamais si Jeanie a lu cet article, mais je suis persuadée que, comme bien d’autres à Glasgow, elle connaissait très bien Quarrier et admirait son travail de bienfaisance. Compte tenu des logements insalubres, des conditions de travail déplorables et de la pollution à Gartsherrie et dans les environs, le Canada devait paraître comme un endroit sain et sécuritaire où les enfants démunis pourraient prospérer.
Le 10 décembre 1885, John et Robert Greenhorn deviennent pensionnaires à l’orphelinat. Selon les photocopies que m’a fournies ma tante Anna, Jeanie y a amené les deux garçons. Elle a accepté qu’ils aillent au Canada après que M. Colin, pasteur de l’église baptiste à Coatbridge, lui a donné tous les détails de l’organisation. Quant au petit Norval, trois ans, il est hébergé par une de ses tantes Greenhorn vivant à Haddington, à l’est d’Édimbourg.
Robert et John vivent au City Orphan Home, à Glasgow, pendant six mois. Le 11 juin 1886, ils déménagent à l’Orphan Homes of Scotland, à Bridge of Weir. Je n’ai trouvé aucune photo de l’intérieur de l’orphelinat à Glasgow, mais je suppose que mon grand-père et mon grand-oncle ont connu des dortoirs semblables à celui de l’orphelinat à Huberdeau, au Québec.

Le dortoir à l’orphelinat d’Huberdeau, Québec, en 1926 (e004665752).
Dans la troisième partie de cette série, l’histoire de Robert Roy Greenhorn nous mènera de l’Orphan Homes of Scotland, à Bridge of Weir, à la maison Fairknowe, à Brockville en Ontario, au Canada.
Beth Greenhorn est gestionnaire de l’équipe du contenu en ligne à la Direction générale de la diffusion et de l’engagement à Bibliothèque et Archives Canada.